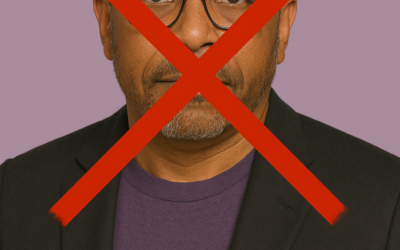Femmes de pouvoir ou pouvoir des femmes ?
On salue aujourd’hui Sanae Takaichi, première femme à diriger le Japon comme une avancée historique. Et c’en est une, bien sûr.
Mais une fois le symbole passé, il reste la question que peu osent poser : pourquoi le pouvoir féminin semble-t-il plus facilement accepté quand il se drape de conservatisme ou d’imagerie traditionnelle?
De Margaret Thatcher à Golda Meir, d’Indira Gandhi à Giorgia Meloni, l’histoire semble avoir une constante : les femmes qui accèdent au sommet sont souvent celles qui ne menacent pas l’ordre établi — ou qui, mieux encore, le confortent.
Elles rassurent, incarnent la discipline, la continuité, l’autorité. Elles prouvent que oui, une femme peut gouverner… à condition de gouverner comme un homme. Femmes dites fortes souvent belligérantes, souvent intolérantes et encore plus souvent à droite, voire très à droite de l’échiquier politique quels que soient les pays.
Le paradoxe est saisissant : plus une société reste inégalitaire, plus la figure féminine qui triomphe est celle qui rassure, traditionnelle, pas celle qui bouscule. Le Japon ne fait pas exception — pas plus que la France, l’Italie ou les États-Unis.
Des électeurs qui sont d’abord des électrices.
En Europe comme ailleurs, les femmes votent davantage que les hommes. C’est cela le paradoxe !
Alors, peut-être faut-il aussi interroger notre propre maturité politique, nous les femmes.
Pourquoi, dans un continent où les électrices sont majoritaires, les modèles féminins qui s’imposent sont-ils si souvent conservateurs ?
Pourquoi l’autorité au féminin passe-t-elle encore par la rigueur, le “courage dit viril”, la défense de l’ordre plutôt que par la transformation sociale ?
Les contre-exemples existent, heureusement : Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, Claudia Sheinbaum au Mexique, Judith Suminwa Tuluka en RDC — trois femmes qui ont prouvé qu’on peut gouverner autrement, avec humanité et conviction.
Mais elles restent minoritaires, presque exceptionnelles.
Des modèles qui n’arrivent pas à casser le plafond de verre
Aux États-Unis, Hillary Clinton et Kamala Harris ont tenté de casser ce plafond symbolique.
Elles n’ont pas échoué parce qu’elles étaient femmes — mais parce que ce qu’elles incarnaient la complexité, la nuance, la compétence. Cela reste encore moins électoralement “vendable” qu’un slogan musclé ou une posture d’ordre.
Et puis, il y a les autres. Celles qui n’ont pas rassuré, celles qui ont osé et qui ont été punies
Benazir Bhutto, assassinée pour avoir incarné une femme libre dans un pays qui ne l’était pas.
Dilma Rousseff, renversée au Brésil après un procès que la justice elle-même reconnaît aujourd’hui comme biaisé.
Des femmes dont le crime fut de gouverner autrement : avec transparence, avec conviction, avec cette force tranquille que le patriarcat ne sait pas nommer autrement que “faiblesse”. Ce qu’on leur a fait payer, c’est moins le pouvoir que l’audace. L’audace d’exister politiquement sans se couler dans le moule. Et tant qu’il faudra mourir, être destituée ou ridiculisée pour oser penser autrement, il est à parier que cela ne changera pas.
La question du pouvoir féminin restera indissociable de celle du risque physique et symbolique. La question n’est donc plus de savoir si les femmes peuvent gouverner. Mais quelles femmes nous choisissons pour le faire. Et ce que nos votes, à nous les électrices, disent de notre propre confiance politique et de nos représentations. Parce qu’à force d’applaudir les symboles, on finit parfois par oublier le sens.
Quelques sources :
Aux USA : lire
Toujours aux Usa : lire
vote des femmes et genre : lire
Pourquoi les femmes ne votent elles pas pour d’autres femmes ? Lire
Oxfam : le vote des femmes – lire